Coup de vent
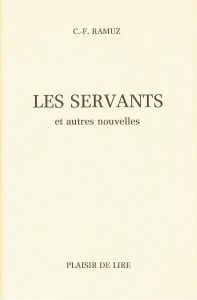
Coup de Vent, nouvelle extraite du livre, Les Servants et autres nouvelles de C.-F Ramuz
Autres romans du même auteur dans notre catalogue : https://www.plaisirdelire.ch/boutique
24 titres dont Aline, Farinet ou la fausse monnaie, Vie de Samuel Belet, La beauté sur la terre, Si le soleil de revenait pas…
Un gros orage éclate de l’autre côté de la bâche, mais nous ne nous en préoccupons pas. Nous ne savons même pas qu’il existe. Car cette mince épaisseur de toile forme séparation entre deux mondes qui s’ignorent. Dans l’un, il fait nuit. Mais, nous, dans l’autre, nous avons la lumière, notre lumière à nous, et nous échappons à la nuit. Dans l’un, le vent souffle, le tonnerre gronde, mais nous, nous habitons un petit univers à nous, paisible, tandis qu’au-dessus de nous, la toile mal tendue se plisse et se couvre de rides qui la parcourent d’un bout à l’autre comme la peau d’un cheval qui a des mouches. Nous ne nous en apercevons pas. Et le tonnerre, on ne l’entend pas même, à cause des dix musiciens, perchés sur une estrade, avec leurs trompettes, leurs cymbales, leur grosse caisse. La foudre nous tombant dessus, est-ce que nous y ferions seulement attention ? Nos yeux sont détournés d’où elle règne en maîtresse. Elle ne peut plus nous atteindre, du moins dans nos esprits. Eux aussi, sont tournés ailleurs, et n’y croient plus et y échappent. On paie un ou deux francs ; on entre, on prend place sur les gradins. Et tout aussitôt les regards se fixent là où l’éclat des projecteurs les invite à se fixer, les yeux ont un point de rencontre, un centre commun, hors de la nature.
Deux trapèzes devant nous se balancent dans le vide. Deux formes de blancheur y pendent la tête en bas, dans le brillantement de la verroterie. Les trapèzes se balancent avec la précision, la méticulosité des astres. Ils vont et viennent régulièrement à la rencontre l’un de l’autre, puis l’un d’eux est lâché par celle qui l’occupe et elle traverse devant nous les airs, mais ses ailes sont des bras. Et, au moment où elle va retomber, elle est recueillie par deux mains, et reprend son balancement, puis est de nouveau quittée et s’engage sur le chemin du retour en tournant sur elle-même. De nouveau, elles sont deux, deux personnes séparées. Oh ! si harmonieusement rapprochées l’une de l’autre quand même, oh ! jusqu’à se toucher – de nouveau séparées, et elles se rejoignent.
Elles ont des cheveux doux, beaux à voir, tandis qu’ainsi elles vont et viennent, et on distingue qui luisent doucement leurs bras lisses et leurs jambes fortes, tandis que leurs cheveux flottent sur leurs épaules ou, tout à coup défaits comme ceux des noyés, et obéissant à leur propre poids, pendent verticalement vers la terre.
Comment entendrait-on le vent, la pluie, le tonnerre ? Nous sommes dans les régions de l’harmonie et de la paix. Si un éclair arrive à percer par un interstice dans les toiles, il vient aussitôt mourir et retombe vaincu par deux foyers, insupportables à voir, avec leur miroir à facettes d’où partent des rayons qui vont frapper les ouvrières du miracle, lesquelles continuent à régner, à souverainement régner, à graviter là-haut, l’une autour de l’autre, comme la lune et le soleil.
La chose s’est passée quand nous nous y attendions le moins. On n’a même pas entendu le fracas épouvantable de la foudre qui vient de s’abattre sur quelque maison du quartier, ni le rauque hurlement d’un coup de vent qui a suivi, on n’a même pas vu la bâche se soulever.
Mais, prise par-dessous par la force de l’air et par lui déchirée, voilà alors qu’elle s’envole. Nous avons été plongés dans la nuit. On ne sait plus ce qui arrive, les projecteurs se sont éteints. On est dans l’eau, on est dans la nuit pêle-mêle. On veut fuir, on se marche dessus. Les femmes crient, les enfants appellent, tout le monde s’est levé à la fois. On cherche à fuir, on ne voit rien. La pluie vous frappe sur la tête, venue d’en haut comme des lances ; elles brillent brusquement, elles s’éteignent, c’est un éclair, on retombe dans les ténèbres. On cherche à fuir, on lève la jambe, on se prend le pied dans les gradins, on s’étale sur le ventre. Et il y a ceux qui sont pris sous la toile, qui d’abord, déverse sur eux toute l’eau dont elle est chargée : noyés, étouffés, étranglés, qui n’ont même plus de voix, et se débattent étrangement, pendant que les pompiers arrivent.
Mais à quoi peuvent-ils bien servir ? C’est petit, c’est noir, c’est des hommes. Ils donnent des ordres ; ils crient : « Par ici. » On ne les voit même pas, c’est des hommes. Même quand le zigzag de l’éclair est dans le ciel, faisant avancer comme des tiroirs les façades des maisons qui entourent la place, à peine s’ils sont aperçus.
Nous nous débattons pendant ce temps.
Que serions-nous devenus sans ces personnes de lumière, quand un premier éclair les a fait paraître devant nous, pour nous dire de les suivre ? Elles viennent à notre secours, elles sont descendues sur la terre où nous sommes de nouveau. Elles sont dans la nuit comme nous. Elles sont blanches, elles lèvent le bras, elles se tiennent bien droites. Elles imposent l’ordre, parce qu’elles sont l’ordre elles-mêmes.
Alors, on s’est mis à les suivre ; on se disait « C’est elles. Elles ne nous abandonnent pas. » Nous leur avons fait confiance, nous tous, femmes, enfants, petits vieux, ceux qui se sont tordu le pied, ceux qui saignent du nez, ceux qui ont un bandage au front, celles qui portent un enfant dans les bras, celles qui boitent. Tous et toutes, parce que les personnes sont toujours devant nous et, se retournant par moment, éclairées par le feu d’en haut, nous font signe de la main.
Il pleuvait toujours, mais de moins en moins ; et le ciel s’embrasait bien encore par moment, mais l’orage s’éloignait. Le vent se calme. On marchait dans les flaques, mais on marchait avec confiance dans les flaques, parce qu’on s’est retrouvé soi-même et qu’on retrouvait son chemin. Toute cette foule. Elles devant. Et alors, elles se sont peu à peu effacées. Quand on a eu plus besoin d’elles, elles ont disparu. Mais, nous autres, on s’était déjà engagé dans une rue qu’on reconnaît bien : c’est celle qui mène chez nous. Où sont-elles ? Elles ne sont plus là. On les a bien un peu cherchées, mais l’orage s’est éloigné.
– Qu’est-ce que vous voulez ? dit quelqu’un. On se débrouillera sans elles.
Et elles n’étaient plus là ; mais ce quelqu’un a dit encore :
– C’est là-bas.
Il montrait quelque chose d’allongé, des espèces de caisses basses montées sur roues. C’est peint en vert.
Maison des artistes.




