Derborence
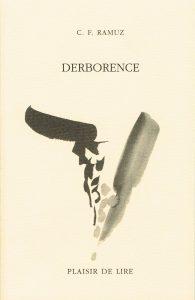
Extrait de Derborence de C.F. Ramuz
Autres romans du même auteur dans notre catalogue : https://www.plaisirdelire.ch/boutique
24 titres dont Aline, Farinet ou la fausse monnaie, Vie de Samuel Belet, La beauté sur la terre, Si le soleil de revenait pas…
EXTRAIT de DERBORENCE
Derborence, le mot chante doux ; il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur et marqué, puis hésite et retombe, pendant qu’on se le chante encore, Derborence, et finit à vide, comme s’il voulait signifier par là la ruine, l’isolement, l’oubli.
Car la désolation est maintenant sur les lieux qu’il désigne ; plus aucun troupeau n’y monte, l’homme lui-même s’en est détourné. C’est à cinq ou six heures de la plaine, quand on vient de l’ouest, c’est-à-dire du Pays de Vaud. Derborence, où est-ce ? On vous dit : « C’est là-bas derrière ». Il faut monter longtemps en sens inverse d’un torrent à la belle eau qui est comme de l’air au-dessus des pierres de son lit, tellement elle est transparente. Derborence, c’est entre deux longues arêtes irrégulières qu’il faut d’abord longuement s’élever ; elles sont comme deux lames de couteau dont le dos serait fiché en terre et le tranchant tout ébréché montre son acier qui brille par places, et ailleurs est rongé de rouille. Et, à droite et à gauche, elles augmentent de hauteur, ces arêtes; à mesure qu’on s’élève, elles s’élèvent elles-mêmes ; et le mot continue à vous chanter doux dans la tête pendant qu’on passe près des beaux chalets d’en bas, qui sont longs, bien crépis de blanc, avec un toit fait de bardeaux semblables à des cailles de poisson. Il y a des étables pour les bêtes, il y a de riches fontaines.
On monte toujours ; la pente raidit. On est arrivé maintenant dans de grands pâturages, tout coupés de ressauts pierreux qui leur font des étages successifs. On passe d’un de ces étages au suivant. On n’est déjà plus bien loin de Derborence ; on n’est plus bien loin non plus de la région des glaciers, parce qu’à force de monter on arrive finalement à un endroit qui est un col, lequel est formé par le resserrement des chaînes juste au-dessus des pâturages et des chalets d’Anzeindaz, qui font là comme un petit village, peu avant que l’herbe elle-même cesse et depuis longtemps il n’y a plus d’arbres.
Derborence, c’est là tout près. On n’a plus qu’à aller droit devant soi.
Et, tout à coup, le sol vous manque sous les pieds.
Tout à coup, la ligne du pâturage, qui s’affaisse dans son milieu, se met à tracer dans rien du tout sa courbe creuse. Et on voit qu’on est arrivé parce qu’un immense trou s’ouvre brusquement devant vous, tant de forme ovale, tant comme une vaste corbeille aux parois verticales, sur laquelle il faut se pencher, parce qu’on est soi-même à près de deux mille mètres et c’est cinq ou six cents mètres plus bas qu’est son fond.
On se penche, on avance un peu la tête.
Un peu de froid vous est soufflé à la figure.
Derborence, c’est d’abord un peu d’hiver qui vous vient contre en plein été, parce que l’ombre y habite presque toute la journée, y faisant son séjour même quand le soleil est à son plus haut point dans le ciel. Et on voit qu’il n’y a plus là que des pierres, et des pierres, et encore des pierres.
Les parois tombent à pic de tous les côtés, plus ou moins hautes, plus ou moins lisses, tandis que le sentier se glisse contre celle qui est au-dessous de vous en se tortillant sur lui-même comme un ver ; et, où que vous portiez vos regards, en face de vous comme à votre gauche et à votre droite, c’est, debout ou couchée à plat, suspendue dans l’air ou tombée, c’est, s’avançant en éperons ou retirée en arrière, ou encore faisant des plis qui sont d’étroites gorges – c’est partout la roche, rien que la roche, partout sa même désolation.
Le soleil qui est sur elle partiellement la colore encore de façons diverses, parce que l’une des chaînes projette son ombre sur l’autre et celle des chaînes qui est au midi projette son ombre sur celle qui est au nord ; et on voit le haut des parois qui est jaune comme le raisin mûr, ou qui est rose comme la rose.
Mais l’ombre monte déjà, elle monte toujours plus ; elle s’élève à petits coups, irrésistiblement, comme fait l’eau dans le bassin d’une fontaine ; et, à mesure qu’elle monte, tout s’éteint, tout se refroidit, tout se tait, tout défaille et meurt ; pendant qu’une même triste couleur, une même teinte bleuâtre se répand comme un fin brouillard au-dessous de vous, à travers quoi on voit deux petits lacs mornes luire encore un peu, puis cesser de luire, posés à plat dans le désordre comme des toitures de zinc.
Car il y a encore ce fond, mais regardez bien : rien n’y bouge. Vous avez beau regarder longtemps et avec attention: tout y est immobilité. Regardez: des hautes parois du nord à celles du sud, nulle part il n’y a plus de place pour la vie. Tout est recouvert au contraire par ce qui est son empêchement.
Il y a quelque chose qui est mis partout entre ce qui est vivant et nous. C’est d’abord comme du sable dont le cône par son petit bout est à demi engagé dans la paroi du nord; et de là, partout répandus, comme des dés hors du cornet, c’est en effet comme des dés, des dés de toutes les grosseurs, un bloc qui est carré, un autre bloc qui est carré, des superpositions de blocs, puis des successions de blocs, petits et gros, recouvrant ce fond à perte de vue.
Autrefois, pourtant, ils y montaient en grand nombre, à Derborence ; on assure même qu’ils étaient près d’une cinquantaine à y monter, certaines années.
Ils y montaient par la gorge qui débouche à son autre bout sur le Rhône; ils venaient d’Aïre et de Premier qui sont des villages valaisans haut perchés sur le versant nord de la vallée du Rhône.
Ils déménageaient vers le milieu de juin avec leurs petites vaches brunes et leurs chèvres, ayant construit là-haut à leur usage beaucoup de chalets en pierre sèche, couverts de feuilles d’ardoise, où ils restaient deux ou trois mois.
Ces fonds en ce temps-là étaient dès le mois de mai tout peints d’une belle couleur verte, car là-haut c’est le mois de mai qui tient le pinceau.
Là-haut (on dit « là-haut » quand on vient du Valais, mais quand on vient d’Anzeindaz on dit « là en bas » ou « là au fond »), la neige, en se retirant, faisait de gros bourrelets ; ils découvraient sur leurs bords, dans l’humidité noire que la vieille herbe recouvrait mal d’une espèce de feutre terne, toute espèce de petites fleurs s’ouvrant à l’extrême limite d’une frange de glace plus mince que du verre à vitre. Toute espèce de petites fleurs de la montagne avec leur extraordinaire éclat, leur extraordinaire pureté, leurs extraordinaires couleurs: plus blanches que la neige, plus bleues que le ciel, ou orange vif, ou violettes: les crocus, les anémones, les primevères des pharmaciens. Elles faisaient de loin, entre les taches grises de la neige qui allaient se rétrécissant, des taches éclatantes. Comme sur un foulard de soie, un de ces foulards que les filles achètent en ville, quand elles y descendent pour la foire, à la Saint-Pierre ou à la Saint-Joseph. Puis c’est le fond même de l’étoffe qui change ; le gris et le blanc s’en allaient ; le vert éclatait de partout : c’est la sève qui repart, c’est l’herbe qui se montre à nouveau; c’est comme si le peintre avait d’abord laissé tomber de son pinceau des gouttes de couleur verte, puis elles se rejoignaient.
Ah ! Derborence, tu tais belle, en ce temps-là, belle et plaisante et accueillante, te tenant prête dès le commencement de juin pour les hommes qui allaient venir. Ils n’attendaient que ce signe de toi. Un après-midi, le bruit diffus et monotone du torrent dans sa gorge laissait entendre, en s’entr’ouvrant, le tintement d’une sonnaille ; il était percé et fendu. On voyait paraître une première bête, puis dix, puis quinze, puis jusqu’à cent.
Le petit berger des chèvres soufflait dans sa corne.
Ils allumaient le feu dans les chalets ; partout en haut des cheminées ou par les trous des portes, un joli petit plumet bleu balançait doucement dans l’absence de tout courant d’air.
Les fumées grandissaient, elles s’aplatissaient du bout, elles se trouvaient confondues dans leur partie supérieure, faisant comme un plafond transparent, comme une toile d’araignée, tendue à plat, à mi-hauteur des parois au-dessus de vous.
Et, dessous, la vie reprenait et la vie continuait, avec ces toits posés non loin les uns des autres comme des petits livres sur un tapis vert, tous ces toits reliés en gris ; avec deux ou trois petits ruisseaux qui brillaient par place comme quand on lève un sabre ; avec des points ronds et des points ovales qui bougeaient un peu partout, les points ronds étant les hommes, les points ovales tant les vaches.
Quand Derborence était encore habitée, c’est-à-dire avant que la montagne fût tombée.
Mais à présent elle vient de tomber.




