La Petite Fille dans le miroir – Extrait
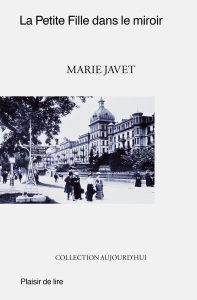
Extrait de La Petite Fille dans le miroir de Marie Javet
Interlaken, Suisse 5 août 2012
La femme assise à la terrasse de l’hôtel de luxe regardait passer les promeneurs. Après une journée caniculaire, elle profitait des derniers rayons du soleil. Une légère brise venait chasser la touffeur de la journée. Devant elle, sur la table, une théière d’infusion, une tasse à moitié vide, et Persuasion, le roman de Jane Austen qu’elle lirait plus tard, pour tromper les heures d’insomnie.
Les gens qui déambulaient le long du Höheweg, touristes de tous horizons, semblaient apprécier le léger rafraîchissement de la température. Les derniers parapentistes de la journée se posaient en douceur et avec une aisance trompeuse sur le Höhematte, un immense parc sans arbres ni plan d’eau, une vaste étendue d’herbe, presque un terrain vague en réalité. Les adeptes de sensations fortes en avaient eu pour leur argent, avec un ciel aussi dégagé. La Jungfrau se dressait, au loin, majestueuse jeune femme dans sa parure de neiges éternelles.
La femme à la terrasse de l’hôtel laissait son regard vagabonder sur les montagnes, les parapentistes et les promeneurs, hésitant entre un panorama grandiose et immuable, et le spectacle sans cesse renouvelé de la diversité humaine. Parmi cette foule multiculturelle qui arpentait les rues au pas d’une promenade digestive, elle se sentait complètement anonyme, et c’était exactement ce qu’elle recherchait.
En Amérique du Nord, son pays d’origine, elle était June Lajoie, écrivain à succès, auteure de plusieurs sagas adaptées à la télévision et au cinéma. De l’autre côté de l’Atlantique, elle protégeait farouchement sa vie privée, se terrait dans sa propriété de Greenwich, Connecticut, derrière des murs de pierre de deux mètres de haut et un portail équipé d’une caméra de sécurité. Une paire de molosses, Néron et Attila, se tenaient prêts à festoyer sur les mollets des intrus.
Malgré l’absence de ces barrières, ici, nul ne l’embêtait. Sa photographie, sur le dos de ses bestsellers, datait d’une bonne dizaine d’années. Elle se refusait à la mettre à jour, malgré les demandes de son éditeur. Peu de gens la reconnaissaient. Son pantalon large et sa chemise longue et flottante, en lin blanc, son chapeau à large bord, ses lunettes de soleil qui lui mangeaient la moitié du visage, ses gants blancs de coton fin pour la protéger d’une hypothétique allergie au soleil, composaient un accoutrement qui, dans son esprit, aidait à la rendre invisible.
Mais surtout, la Suisse était connue comme un havre de paix pour les personnes souffrant des effets pervers de la célébrité. Ici, les gens ne vous accostaient pas à la terrasse d’un café pour vous demander un autographe, ne s’imposaient pas pour s’immortaliser à vos côtés sur l’écran de leur iPhone, ne troublaient en aucune façon votre quiétude. Tout juste lançaient-ils quelques regards appuyés et chuchotaient-ils entre eux. Vous et votre notoriété pouviez profiter de vos vacances tranquillement.
Elle n’était pas retournée en Suisse depuis deux décennies. Et il y a vingt ans, elle n’avait aucune notoriété à cacher. Elle aurait pu être elle-même. Et pourtant…
Son premier roman la ramenait dix-huit ans en arrière, une période de sa vie à laquelle elle n’aimait pas songer, si tant est qu’elle eût des moments de sa vie qu’elle se plût à se remémorer. Bien sûr, il y avait eu ces quelques semaines, entre le printemps et l’été 1992. Elle avait approché le bonheur de très près, cette année-là. Pour la première et la dernière fois, elle avait connu la liberté… et l’amour. Mais elle avait chèrement payé ces moments de grâce. Et à cela, elle refusait de penser. Deux ans après cette parenthèse hors du temps, était sorti ce qui deviendrait le premier volume de la quadrilogie Asylum, dont la traduction française plus qu’insatisfaisante, L’Hôpital psychiatrique, ne véhiculait pas l’atmosphère de l’institution inquiétante de son roman, bien loin de l’endroit moderne où l’on traite des troubles mentaux et autres affections de l’âme. Mais à l’époque, elle n’avait pas eu son mot à dire face à l’éditeur français. Les exigences étaient venues plus tard, avec le succès. Elle avait d’ailleurs acquis la réputation d’être plutôt dure en affaires. Elle savait que son éditeur français l’appelait dans son dos l’emmerdeuse, surnom qu’elle avait largement mérité. Mais à l’époque, moins revendicatrice, elle avait tenté timidement de faire passer l’idée que l’asylumanglosaxon véhiculait à lui seul l’image du bâtiment sordide de l’époque victorienne, celui dans lequel on enfermait à vie les gens différents, les femmes un peu trop libres de mœurs et qualifiées d’hystériques. Il était l’endroit honni qui rimait avec bains glacés, camisoles de force et chambres capitonnées, ou pis encore, trépanations et lobotomies. Ces scènes atroces figuraient en bonne place dans son récit, et la traduction française, L’Hôpital psychiatrique, ne les évoquait pas.
Avec cette série aussi trépidante qu’angoissante, elle n’avait pas connu une notoriété immédiate, mais avait néanmoins percé dans le monde jalousé des écrivains prometteurs. Le New York Timesl’avait désignée comme jeune auteure « à suivre». À seulement 22 ans, elle avait une « plume assurée», un style « poétique et onirique» et elle « redonnait ses lettres de noblesse à un genre gothique mille fois revisité depuis sa période glorieuse du XIXe siècle». Mieux encore, on la comparait à une Virginia C. Andrews – auteure américaine ayant connu un grand succès dans les années quatre-vingts avec des séries gothiques dont les héroïnes étaient des adolescentes –, mais une Virginia C. Andrews « avec des ambitions littéraires» avait précisé le critique du New York Times. Elle avait conservé la coupure du journal, ainsi que toutes celles qui lui avaient été consacrées par la suite, dans un gros classeur bleu. C’est avec la série suivante, L’Immortel de Sleepy Hollow, qu’elle était entrée au panthéon des auteurs de best-sellers. Ces cinq romans, qui présentaient un héros à la fois raffiné et sanguinaire, séducteur romantique et tueur aux allures de justicier, s’étaient succédé en librairie en parallèle à la Chronique des vampires, de l’écrivain Anne Rice. Les deux femmes se disputaient ainsi les faveurs du public et la première place des ventes. Si Anne Rice avait élu la Louisiane pour y abriter ses vampires, June Lajoie avait choisi la Nouvelle-Angleterre dans laquelle elle était née et où elle était revenue vivre à l’âge adulte. La sortie du film à succès Entretien avec un vampire, adapté du roman d’Anne Rice, avait annoncé l’enthousiasme qui accueillerait, quatre ans plus tard, le premier opus des aventures de L’Immortel de Sleepy Hollow.
Colin Firth accepta d’incarner Lloyd McCoy, héros de la série, vampire sexy à l’accent british, qui avait fait se pâmer les spectatrices américaines. Un an plus tard, l’acteur, choisi pour le rôle de Darcy dans Bridget Jones, était définitivement propulsé au rang de star internationale. Sa nouvelle notoriété relança l’intérêt pour ses rôles précédents, et l’irrésistible Lloyd McCoy assura à June Lajoie la position de New York Times Best Sellerpour chacun de ses romans de vampires, ainsi que toutes les séries qui allaient suivre.
June n’avait rencontré Colin qu’une seule fois, lors d’une cérémonie de récompenses, et avait perdu tous ses moyens devant le séduisant acteur, bafouillant et rougissant, incapable de trouver les mots qui coulaient si aisément sur le papier. Elle n’était décidément faite ni pour ce genre d’événements publics, ni pour se frotter aux stars hollywoodiennes.
June n’avait jamais recherché la notoriété. Au contraire, si elle avait pu mener une existence de transparence parfaite, elle aurait été comblée. Simplement, écrire était le fil ténu qui la rattachait à la vie. C’était la planche salutaire qui l’empêchait de se noyer. Ses mondes imaginaires lui permettaient d’exister sur une autre sphère, parallèle au monde réel, dans lequel elle se sentait si souvent en décalage, comme superflue. Elle s’était protégée de cette célébrité malvenue en refusant les interviews télévisées, en raréfiant les séances de dédicaces jusqu’à les supprimer totalement. Porter des vêtements larges et confortables qui dissimulaient son corps plutôt maigre, et des lunettes de soleil qu’elle arborait en permanence sous prétexte d’une grande sensibilité oculaire, l’aidaient en réalité à se cacher du regard des autres.
À présent attablée à la terrasse de l’hôtel, elle regardait déambuler une famille saoudienne. Deux hommes en polos et bermudas marchaient en tête, un garçon d’une dizaine d’années et une petite fille de trois ou quatre ans gambadant autour d’eux. Environ deux mètres en arrière, trois femmes bavardaient, deux d’entre elles précédées de poussettes. Elles étaient voilées intégralement, selon la tradition de l’islam wahhabite. June était maintenant habituée à les regarder passer. La seule chose qui distinguait l’une de ces femmes des deux autres était un ventre très arrondi, qui distendait l’abaya noire. La première fois qu’elle avait croisé une femme entièrement dissimulée aux yeux du monde, dont on ne percevait que les yeux sous le niqab, elle avait été choquée. Puis elle avait songé à son propre accoutrement, son grand chapeau et ses énormes lunettes destinées à cacher ses yeux et une partie de son visage. Ses gants qui protégeaient ses mains du soleil, mais aussi du regard des gens, des mains inutiles, qui ne servaient qu’à frapper les touches du clavier. Au moins ces femmes orientales avaient-elles l’excuse de se trouver sous le joug d’une tradition culturelle et religieuse qui était celle de leur pays, de leurs ancêtres. Contrairement à June, elles n’avaient jamais eu le choix, tandis que sa propre décision de se cacher derrière une tenue et un pseudonyme était consciente. Elle avait bâti sa propre prison. À leur silhouette noire, elle renvoyait l’allure d’un fantôme blanc. Si elle avait pu porter un voile sans susciter une curiosité supplémentaire, elle l’aurait sûrement fait.
Elle pensa à la nouvelle de l’auteur américain du XIXe siècle Nathaniel Hawthorne, Le Voile noir du pasteur, l’histoire d’un prédicateur très apprécié de sa petite communauté de fidèles, qui commence à arborer, du jour au lendemain et sans explication, un voile noir devant le visage, suscitant ainsi la stupéfaction et l’incompréhension de sa congrégation. Le voile devient alors le symbole d’un terrible secret, jamais révélé, qui le sépare d’eux, et qui éloigne de lui l’amour et la sympathie de ses semblables tout en suscitant la crainte, l’effroi et le respect. June avait lu cette nouvelle à l’aube de ses vingt ans, et en avait été durablement marquée, sans se douter qu’elle aurait un jour son propre secret à dissimuler aux yeux du monde, qu’elle aussi serait, comme le pauvre pasteur, enfermée « dans la plus triste des prisons, celle de son propre cœur».
Elle consulta la montre à son poignet. Il était presque 21 h 30, temps pour elle de regagner sa chambre, de lire une heure ou deux, avant d’essayer de trouver, si cela était possible, un sommeil trop souvent élusif. Le lendemain, comme tous les matins, elle se réveillerait tôt. Ses journées se déroulaient selon un emploi du temps régulier. Elle se levait à six heures, se faisait monter dans la chambre un petit déjeuner composé d’un jus d’orange pressée, de deux toasts de pain complet, d’œufs brouillés, de jambon cuit et d’une théière de Earl Grey qu’elle faisait remplacer sitôt la dernière goutte bue, trois ou quatre fois durant la matinée. Son repas terminé et encore vêtue de sa chemise de nuit et d’un fin peignoir de soie, elle s’installait, tasse de thé à portée de main, derrière son bureau, sur lequel était posé son ordinateur portable. Elle commençait alors son travail d’écrivain, qu’elle poursuivait jusqu’à midi, sans autre interruption qu’un appel à la réception pour pallier le manque de carburant signifié par la théière vide. Le personnel avait pour consigne de ne pas la déranger. Sa chambre n’était nettoyée qu’entre midi trente et quatorze heures, moment auquel elle allait, après avoir pris sa douche et s’être habillée, prendre un déjeuner léger, club sandwich végétarien ou assiette de saumon fumé, à la terrasse du bar de l’hôtel.
Son emploi du temps était le même à Interlaken qu’à Greenwich, immuable depuis le début de sa carrière d’écrivain. Ses matinées étaient consacrées à la création, à l’invention de nouveaux personnages, de trames de romans inédites, ou au peaufinage de ceux qui avaient déjà germé dans son imagination fertile. Elle se livrait à cette activité tous les jours, week-ends et vacances compris. Deux fois par an, elle choisissait un lieu de villégiature dans lequel elle transposait son quotidien. Parfois sans quitter les États-Unis – elle se déplaçait alors l’hiver dans sa résidence de Charleston en Caroline du Sud et l’été dans le Massachusetts ou dans le Maine –, parfois en traversant l’Atlantique. Elle avait séjourné entre autres en Italie, en France ou en Angleterre. L’été précédent, elle s’était rendue à Fjällbacka, en Suède. Les polars de Camilla Läckberg lui avaient donné envie de découvrir cette charmante ville portuaire. Le nombre de touristes qu’elle y avait croisés lui avait prouvé qu’elle n’était pas la seule à suivre les pas du sympathique duo d’enquêteurs créé par la romancière suédoise.
Mais cette année, pour la première fois en vingt ans, elle avait choisi de retourner en Suisse. Elle rêvait de plus en plus souvent au lac Léman et aux montagnes alpines, le paysage qui dessinait l’arrière-plan de sa jeunesse. Elle avait arpenté les plages de plusieurs mers et océans, s’était promenée le long des grands lacs américains au pied des Montagnes Rocheuses, mais dans son souvenir, peut-être patiné et embelli par la nostalgie, il n’existait pas de plus beau spectacle qu’une vaste étendue d’eau au pied de la chaîne des Alpes. Il était pourtant impensable qu’elle revienne à Lausanne, ou même à Montreux, les deux villes qu’elle connaissait le mieux et dont elle pouvait encore arpenter les rues dans les méandres de sa mémoire. Elle avait opté pour Interlaken, une autre langue, une autre atmosphère, mais pourtant toujours la Suisse. Sa situation entre le lac de Thoune et celui de Brienz lui avait paru un bon substitut au Léman de sa jeunesse.
Sa routine de l’après-midi dépendait du lieu où elle se trouvait. À Greenwich, elle se faisait conduire par son chauffeur jusqu’au bord de l’océan, parfois à Greenwich même, ou alors à Stamford, ou à Rye, dans l’état voisin de New York. Là, longeant la plage ou la promenade aménagée, elle marchait, été comme hiver, le regard perdu vers l’horizon. Deux heures plus tard, son chauffeur la récupérait au point de départ. Elle ne conduisait pas, n’avait même jamais passé son permis, tant elle craignait qu’entre ses mains un véhicule ne se transforme en engin de mort. Les peurs faisaient partie de son existence et trouvaient dans les actes quotidiens les plus ordinaires un moyen de s’exprimer. Conduire en faisait partie.
À Interlaken, elle n’avait pas son chauffeur à disposition. Il avait profité de son congé annuel pour aller camper avec sa famille au parc de Yosemite, en Californie. June avait cependant la possibilité d’effectuer ses deux heures de marche quotidiennes en partant de l’hôtel à pied. Parfois elle empruntait la direction qui la menait au centre-ville, et dépassait rapidement les rues où les boutiques de souvenirs kitsch accueillaient des flots de touristes, pour s’enfoncer dans les ruelles plus désertes aux maisons charmantes et jardins fleuris que les Suisses allemands avaient pour habitude d’entretenir avec soin. Elle y déambulait au hasard, sans but précis. Mais sa promenade préférée, certainement parce qu’elle y rencontrait très peu de monde, partait de derrière l’hôtel. Elle remontait le cours de l’Aar, jusqu’au lac de Brienz. Sur une grande partie du trajet, l’ombre des arbres l’abritait du soleil et l’eau courant à côté d’elle dégageait une fraîcheur bienfaisante. Pendant ses balades, elle songeait à ses personnages, à comment elle allait amener certains événements, aux difficultés auxquelles elle s’était heurtée le matin même sans pouvoir les résoudre. Au bout d’un moment, elle était tellement absorbée par le murmure de l’eau, le chant des oiseaux ou la vue des montagnes au loin, que le roman sur lequel elle planchait passait à l’arrière-plan. La plupart du temps, elle rentrait de sa promenade fourbue, mais avec la solution à son problème. Elle la consignait alors dans un petit carnet, pour ne pas l’oublier. Ensuite, jusqu’à l’heure du dîner, elle lisait, soit dans sa chambre, soit sur un banc public dans le jardin du casino, tout proche de son hôtel, bercée par le murmure de la fontaine et apaisée par la géométrie des compositions florales.
À dix-neuf heures, elle se faisait monter une soupe et quelques tranches de pain dans sa chambre. Elle ne profitait jamais des trois restaurants aux cuisines aussi succulentes que variées que l’hôtel offrait à sa clientèle, préférant se tenir à l’écart des gens dînant en famille ou en couple. Elle descendait ensuite une heure ou deux s’asseoir sur la terrasse, pour profiter des dernières lueurs du jour et regarder les gens, sans que ceux-ci, occupés à déambuler en bavardant, ne lui prêtent la moindre attention. Et c’était bien ainsi.
C’était une journée ordinaire dans la vie de l’une des écrivains les plus populaires d’Amérique. C’était surtout la journée d’une femme seule, qui portait le voile de la honte et de la disgrâce devant son âme, un voile tombant lourdement entre elle et le monde.