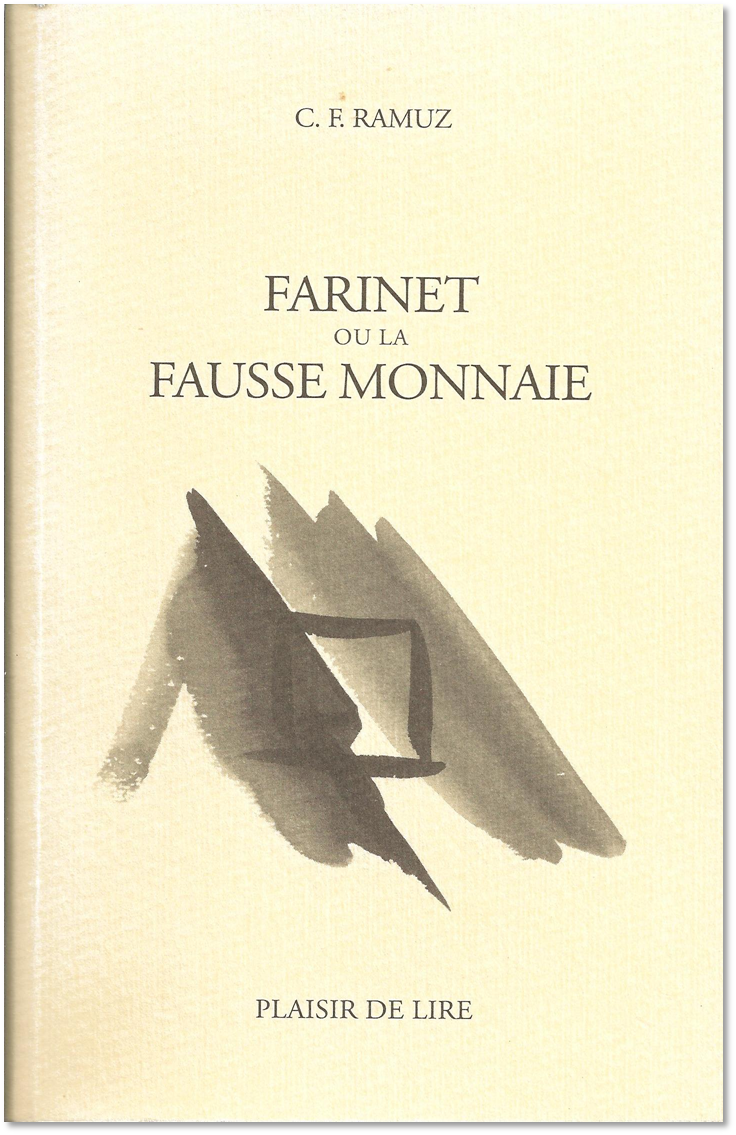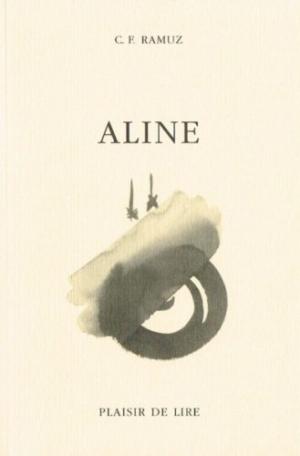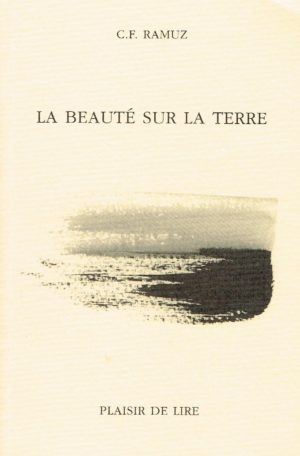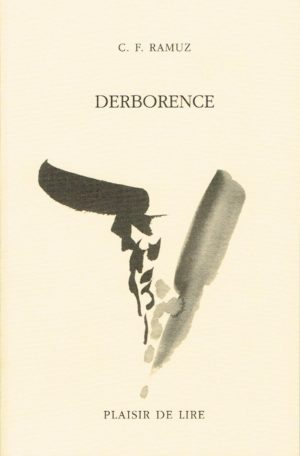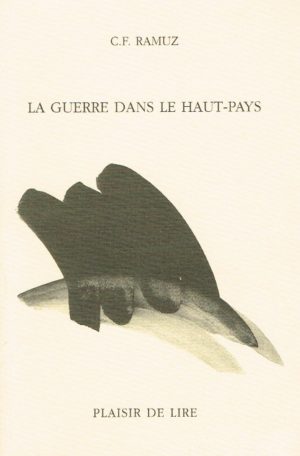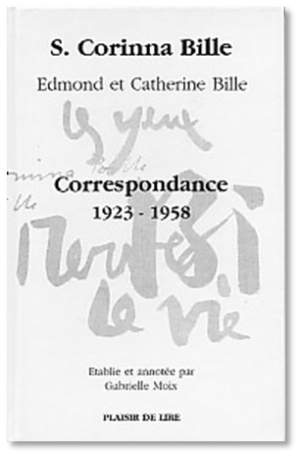Joseph-Samuel Farinet a bel et bien existé. Né en 1845 et mort en 1880, ce faux-monayeur est vite devenu un héros fabuleux. Ce n’est ni le héros de légende, ni le mythe folklorique valaisan, ni même le fait divers en soi, aux allures de roman policier, qui intéressent C.F. Ramuz. Farinet incarne cette liberté que veut célébrer le poète !
Quatrième de couverture: Au-dessus du village de Mièges en Valais, Maurice Farinet, fils de contrebandier, fabrique imperturbablement de la fausse monnaie avec de l’or qu’il recueille au sein de la plus haute montagne surplombant son village. Il écoule ses pièces d’or sans peine auprès des gens du pays, tous acquis à sa cause. N’est-ce pas de l’or pur officiellement attesté? Et cette monnaie n’est-elle pas plus fiable que celle du gouvernement? Arrêté à Aoste et condamné à six ans de réclusion, Farinet s’échappe de prison par deux fois et se réfugie toujours plus haut dans ses montagnes où il se croit invincible. Pourtant, malgré la solidarité villageoise, la proposition d’un compromis qui le fera renoncer à son or et l’amour entrevu dans le regard d’une jeune fille, le destin de cet esprit rebelle à toutes les lois humaines semble joué.
L’histoire de Farinet, cet hymne à la liberté, est racontée par C. F. Ramuz dans une langue rude, simple, à la respiration haletante, reflétant bien le caractère et la vie des montagnards.
Préface de Philippe Renaud
Le farinet de Ramuz : de la légende au mythe
Publié en 1932, Farinet ou la Fausse monnaie est le dix-septième roman de Ramuz et, fait important, le seul dont le héros ait réellement existé ; comparer le Farinet de l’Histoire avec celui qu’a réinventé Ramuz aide à comprendre, et le roman, et comment il a fait passer le personnage du plan de la légende à celui du mythe.
Le Farinet historique[1] (1845-1880) diffère beaucoup de celui qu’a remodelé Ramuz : né dans le Val d’Aoste francophone, il n’était pas Valaisan mais sujet du roi d’Italie, et ne se prénommait pas Maurice ; issu d’une famille misérable, il se mit dès sa jeunesse à fabriquer de la fausse monnaie ; s’évadant d’une prison italienne, il gagne le Valais où, en une décennie, il mettra en circulation des dizaines de milliers de fausses pièces ; condamné à trois reprises (dont deux par contumace), il mène une vie d’évadé hors-la-loi ; la gendarmerie valaisanne le traque sans succès (et mollement semble-t-il) pendant des années, car la population le soutient, le cache, égare les gendarmes sur de fausses pistes – pour diverses raisons : beau, charmeur, sympathique, il est, dit-on, la coqueluche des femmes ; en outre la pauvreté sévit : par générosité naturelle, et pour s’assurer des complicités, il distribue sans compter ses fausses pièces ; quoique dénuées de toute valeur, elles jouissent d’une certaine tolérance, car le canton connaît une crise financière si grave que l’on se méfie de la monnaie officielle ; enfin, la rumeur veut que des politiciens trouvent utile de ménager un homme devenu aussi populaire. Mais la Berne fédérale, se jugeant bafouée, accroît sa pression : en 1880, les gendarmes acculent Farinet dans une gorge proche de Saillon ; il est probable que le fugitif, rompu de fatigue et mourant de faim, a fait une chute mortelle ; mais le bruit courut aussitôt que ses poursuivants l’avaient tué…
Ainsi Farinet, surnommé le Robin des Alpes, faisait figure de bienfaiteur des pauvres, et de héros du petit peuple valaisan ; tout concourait à la création d’une légende ; en effet, de son vivant même, des journaux le qualifièrent de « légendaire » ; une opérette et un char de carnaval célébrèrent ses prouesses... Et sa légende lui survécut.
Mais c’est au roman de Ramuz, et au film qu’on en tira en 1938, que Farinet, de légendaire, doit d’être devenu quasi mythique.
Entre le faux-monnayeur de l’Histoire et le héros de Ramuz, il existe une différence capitale et décisive : le romancier imagine que Farinet possède une mine d’or, et fabrique des pièces valant plus que celles de l’Etat, alors que le « vrai » Farinet n’a jamais trouvé d’or, et que ses pièces ne valaient pas un sou. Ramuz ne raconte-t-il pas une histoire à dormir debout ? Imaginez qu’un de vos amis, pauvre parmi les pauvres, hérite d’une mine d’or : le voilà riche ! S’il vous disait alors : « Plutôt que de vendre mon or, je vais en faire de fausses pièces de monnaie, et tant pis si je suis condamné, emprisonné, et même tué par les gendarmes », que lui diriez-vous, sinon : « Es-tu devenu fou ? » - et vous auriez raison.
Mais Ramuz, lui, n’est pas fou : il a une idée de derrière la tête ; pour la saisir, il faut se rappeler que, depuis des millénaires, la monnaie a été comparée au langage : chose naturelle, puisque tous deux sont des moyens d’échange entre les hommes. On traite les paroles trompeuses et les écrits sans valeur de fausse monnaie ; de plus, beaucoup d’écrivains ont comparé les œuvres littéraires, selon leur qualité, à des pièces d’or ou à des contrefaçons dérisoires.
Or, de nombreux critiques ont reproché à Ramuz de forger une langue qui n’était pas du « vrai français », entendant par là le français « officiel », celui de l’Académie ; loin d’en disconvenir, le romancier répondait que les écrivains authentiques créent « une langue dans la langue ». D’où de vives polémiques, Ramuz soutenant que, pour ce qu’il avait à raconter, son français valait mieux que le français standard. En somme (lui-même l’a écrit), il revendiquait le droit, et plus encore la nécessité, de battre sa propre monnaie, de forger une parole issue du fond de lui-même, de sa terre et de ses habitants.
Durant la période où il écrivait Farinet, Ramuz mettait en scène des héros assoiffés d’absolu ; celui d’Adam et Ève se met en tête de reconstruire le Paradis perdu ; le Garçon savoyard se suicide pour rejoindre l’image d’une femme idéale. Comme Farinet, ces hommes balancent entre deux femmes que tout oppose, et sont (ou se croient) trahis par l’une d’elles. Le Farinet de Ramuz ressemble bien moins à celui de l’Histoire qu’aux personnages des romans que je viens de citer.
Qu’est-ce qui, pour Farinet, représente l’absolu ? On a dit que c’est la liberté ; mais c’est ne pas voir que l’un des sujets principaux du roman est son hésitation entre deux libertés : l’une qu’il nomme douce, l’autre sauvage (104) ; et qu’aucune des deux – là est son drame – n’est viable pour lui ; de plus, un héros (ou martyr) de la liberté pense moins à la sienne propre qu’à celle des autres, celle de son peuple, par exemple. En fait de liberté, Farinet n’a rien à donner. En revanche, il a quelque chose à donner, à partager, qui profite aux autres : son or. C’est de lui, non de la liberté, que ses ultimes paroles font l’éloge (209); c’est, de toute évidence, en lui qu’il croit. S’il choisit la mort, c’est parce que la liberté « douce » ne lui est offerte qu’à la condition qu’il renonce à le faire circuler. Rien ne l’empêcherait de le vendre comme une marchandise ; mais c’est précisément ce qu’il ne désire pas, à quoi il ne pense même pas. Le roman multiplie les indices propres à faire comprendre, en évitant toute explication abstraite, que pour Farinet l’or est l’objet d’une croyance, ou, si l’on veut, d’une mystique. Ramuz met dans sa bouche des mots qui ne sont pas ceux de la chimie, mais d’une alchimie préscientifique : l’or est un « soleil », il est « liquide » ; c’est « la pure décantation de la roche » (61 ; 209); dans une version du roman postérieure à celle que nous donnons ici (édition Grasset), Farinet clame que son or est « la pure fermentation de la substance, son miel même ! […] Le pur, le limpide, le pas gâté ». Pour lui les montagnes, où gît l’or, sont des êtres vivants ; il leur dit qu’elles l’ont lui-même « fait » (189). Mères de Farinet, elles le sont aussi de l’or, décantation de leur substance à la fois matérielle et pensante. La montagne « porte » l’or dans ses entrailles, mais c’est à Farinet qu’il incombe de le mettre au monde, de le sortir de l’obscur « boyau » pour l’amener « à l’air libre ». Le début du chapitre V est le récit d’un accouchement nécessaire, car « l’or n’est pas encore de l’or, pensait-il, tant qu’il est caché sous la terre. Il faut que ça vienne à la lumière pour que ça s’éveille […] ». Puis il reviendra tout naturellement à l’accoucheur de faire de cet or nouveau-né un être capable de marcher, de circuler, une fois accomplie sa mue en pièces de monnaie.
Il n’y a donc pas de rupture, dans cette rêverie archaïque, magique et profonde, entre le « travail » de la nature et celui de l’homme, qui le prolonge et l’accomplit. Dans cette vision du monde, la monnaie de Farinet est la seule bonne, la seule vraie, étant naturelle alors que celle de l’Etat n’a qu’une valeur artificielle et tout arbitraire (chap. I).
Il n’est pas surprenant que Farinet compare l’or qu’il vient d’extraire à du vin et, dans ses dernières paroles, au « plus beau des vins, […] une fois qu’il a fini de bouger ». Lui aussi est le produit d’une collaboration entre la nature et l’homme; lui aussi résulte d’une « fermentation », et doit se « décanter » - les vignerons disent : « finir de bouger ». Et le vin ramuzien n’a de vraie valeur que s’il est rituellement, religieusement partagé, s’il circule. On le voit bien lors du repas au chalet d’alpage (chap. VI), où « le verre avait circulé selon les rites. » Ainsi partagé, le vin, dans cette scène (et dans d’autres romans) crée une communication, une communion entre les hommes, qui, d’ordinaire, sont séparés.
Il n’est donc pas surprenant non plus que Farinet, juste après avoir comparé son or à du vin, le dise « couleur des moissons », du blé que l’homme transforme en pain. Le pain et le vin… Farinet serait-il une sorte de Christ ? Le texte en tout cas le suggère : au chapitre VIII, on entend le héros rêver d’une société nouvelle, où circulerait sa monnaie, qui aurait d’autres lois et pour principe la fraternité. La scène du repas au chalet évoque irrésistiblement la sainte Cène… Comme le Christ, Farinet a des fidèles ; l’une, qui pourtant « aime le servir » (83), le trahit et se fait traiter de « Judas » (184) ; comme le Judas de l’Évangile, prise de remords, elle se pendra ; Farinet, comme le Christ, sait qu’il va mourir ; il meurt en pardonnant à Joséphine ; « il ne nous avait jamais fait que du bien », dit une voix qui résume le sentiment du peuple (212). Voir en Farinet un nouveau Christ serait certes aberrant ; mais rien n’empêche de le considérer, selon les mots d’Apollinaire, comme un « Christ inférieur des obscures espérances »…
Et lui-même, sait-il ce qu’il est ? Ramuz, en véritable artiste, se refuse à nous l’expliquer ; l’un des mots d’ordre qu’il s’est donnés est de « ne jamais rien expliquer » ; un autre, de « faire exprimer des choses par des gens qui ne savent pas les exprimer. / Les suggérer alors par des images […] ». Il désire, écrit-il encore, que les lecteurs interrogent ces images – et c’est ce que nous avons fait. Que nous suggèrent-elles, ces images, ces comparaisons ? Il me semble qu’elles partent toutes d’un même foyer, pareil à la mine de Farinet, où brille la petite flamme d’une aspiration, ou d’une nostalgie, fondamentale: celle d’une régénération de la société des hommes : espoir aussi vivant que vain de la rédemption magique d’un monde « gâté », d’un retour à l’Âge d’Or ; une telle aspiration se nomme un mythe. Et Farinet, même s’il ignore ce qu’est un mythe, sait que son obscure espérance est vouée à l’échec ; n’en pas démordre est sa vraie grandeur.
Mais si son héros, dont l’espérance est folle, échoue tragiquement, Ramuz, lui, réussit ; son roman a suscité (sans que l’auteur l’ait cherché) un « mythe Farinet » dont les fidèles sont aussi nombreux que divers : les années 1960 ont vu la naissance d’une Association sans frontières des Amis de Farinet, « dont le seul but est de faire rêver le monde » ; la Vigne de Farinet (on retrouve le vin) après avoir été donnée à… l’abbé Pierre (on retrouve le Christ), appartient à une autre figure mythique, le dalaï-lama. Trop beau pour être vrai ? Si vous en doutez, tapez sur Internet Saillon et Farinet. Et si vous désirez lire une analyse plus approfondie de l’œuvre, consultez l’édition des Romans de Ramuz dans la Bibliothèque de la Pléiade.
Enfin, félicitons-nous de voir que, contrairement à celui de Farinet, l’or de Ramuz n’a pas cessé de circuler, suscitant d’âge en âge de nouveaux fidèles.
Philippe Renaud
[1] J’emprunte ces informations à la remarquable étude de Danielle Allet-Zwissig : Farinet et sa légende, dans HISTOIRE ET LÉGENDE, Société d’Histoire de la Suisse romande, Lausanne, Dorigny, 1987.