Je m’appelle Jennylyn – Extrait
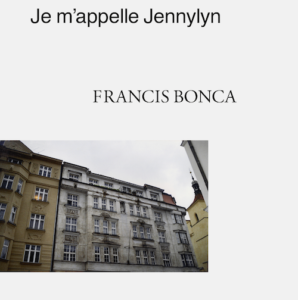
Extrait de Je m’appelle Jennylyn de Francis Bonca
Chapitre I
Je m’appelle Jennylyn. Les gens aiment ce prénom, du moins ceux qui m’entourent, comme la plupart de mes nouvelles connaissances. Quand mon père et ma mère se sont rencontrés, ils sont partis quelques jours à la montagne dans un petit chalet rustique caché au milieu des mélèzes. C’est dans ce nid d’amour que j’ai été conçue, selon les dires de ma mère. Le chalet s’appelait Jennylyn, ce nom était gravé sur une planche au-dessus de la porte d’entrée.
L’habitat en question avait appartenu à des anglais. Ils y avaient résidé, année après année, du printemps jusqu’à l’automne, durant presque quatre décennies. John Lee, qui avait baptisé la maison du prénom de son épouse, formait avec celle-ci un couple uni, exemplaire, que seule la mort sépara, pas pour longtemps cependant puisqu’ils décédèrent à quelques mois d’intervalle. Les héritiers – un fils et une fille à Londres – confièrent le chalet à une agence de la région qui le louait aux touristes amoureux de l’endroit : une station alpestre perchée à 1500 mètres d’altitude.
Quelques semaines après leur séjour à la montagne, ma mère, en rentrant du travail, trouva une lettre dans sa chambre à coucher.
Corinne,
Je crains que mes sentiments pour toi ne soient pas assez forts. À vrai dire, je ne suis sûr de rien ; le doute m’assaille. Et à cause de ce doute, je préfère mettre un terme à notre liaison pendant qu’il en est encore temps : nous nous connaissons depuis deux mois à peine. Nous avons vécu ensemble un moment de bonheur intense à Montana entre les quatre murs du Jennylyn. Toutefois, je ne me sens pas prêt pour la vie à deux. Je m’en rendais compte au fil des jours qui passaient, là-haut à la montagne. Je suis au début d’une carrière littéraire et veux pouvoir y consacrer tout mon temps, mes forces et mon énergie. Aussi, je vais voyager quelques mois durant avant de me fixer dans une ville d’Europe – ailleurs qu’en Suisse où j’étouffe – où je pourrai travailler dans le calme, l’esprit libre de toutes contraintes, si tant est que cela soit possible.
Corinne, j’espère qu’avec le temps tu me pardonneras pour ce qui arrive si brusquement sans que nous ayons pu en parler ensemble. J’ai préféré cette solution, les larmes et les adieux déchirants sont vains, ils ne font qu’attiser la douleur inutilement. Tu as à peine vingt ans, tu es belle et très désirable, tu peux entrevoir l’avenir sans crainte, il est devant toi. Pour nous deux, cet avenir aurait été tourmenté, à tout le moins chaotique. Tu mérites mieux. Quelqu’un a dit que partir, c’est mourir un peu. Il serait donc bon, pour toi comme pour moi, que tu m’oublies vite, que tu ne cherches pas à me retrouver, ni même à me contacter.
Je publie – et continuerai de publier – mes livres sous un pseudonyme que tu ignores, puisque je n’ai pas pris la peine de t’en parler.
Tu sais que ma mère est ukrainienne, née là-bas, qu’elle vit maintenant à Prague, mais que mes grands-parents sont toujours en URSS. Pour l’heure, je vais les retrouver en Crimée, cette terre que j’aime et où règne un éternel printemps. J’y resterai quelques semaines, quelques mois peut-être. Après, c’est l’inconnu…
Je te demande pardon et t’embrasse tendrement.
Mikhaïl
Ce que Mikhaïl ignorait, c’est que Corinne était enceinte. Elle s’apprêtait à lui en faire part – la surprise, comme elle disait naïvement –, mais l’oiseau s’était envolé.
Quelques connaissances et amies de Corinne, et même ses parents, lui suggérèrent de se faire avorter. Elle n’en fit rien. Jeune femme sensible et romantique, dans toute l’acception du terme, elle considérait que l’enfant qu’elle allait mettre au monde témoignerait de son amour, un amour immense dont il serait le prolongement.
Je vis donc le jour quelque huit mois plus tard dans une clinique de Genève, en plein mois d’août, sous le signe du Lion. Ma mère n’eut aucune peine à me trouver un prénom : Jennylyn s’était imposé comme une évidence. Mes grands-parents, qui furent finalement très heureux de ma venue, m’appelèrent souvent leur « petite Jennylyn de l’été ».
Mon enfance se déroula sans problèmes particuliers. En classe, j’étais une élève studieuse. Dès l’âge de cinq ans, ma mère m’inscrivit dans une école de danse. Très vite, je passai pour un élément doué, si bien que les cours étaient devenus pour moi une partie de plaisir. Les heures passées à la barre ne m’ont jamais rebutée. Après quelques années, elles étaient devenues mon pain quotidien. Il sembla donc logique à mes professeurs que je fasse de la danse ma profession. Ma mère ne s’y opposa pas, mais elle me demanda d’envisager une maturité parallèlement au ballet, « Afin de t’ouvrir des portes », disait-elle. Comme j’avais de la facilité pour l’étude – on me reconnaissait une mémoire bien au-dessus de la moyenne, ce qui n’est pas forcément une preuve d’intelligence, mais cette aptitude peut rendre service – j’ai fait ce que ma mère demandait. Je partageais mes journées entre les cours du lycée et le studio de danse. Je préparais une maturité latin/grec et lisais beaucoup. Maman me parlait si souvent de ce père inconnu, écrivain qui vivait quelque part en Europe, que mon intérêt pour les lettres alla croissant et que, petit à petit, la danse céda du terrain à la littérature. Même si j’avais bien les pieds sur terre concernant mon travail scolaire, l’étude de la danse ou mes activités dans la société, je vivais par moments dans un état de rêverie qui me faisait échafauder toutes sortes d’histoires concernant mon père. Je me disais qu’un jour j’allais le rencontrer, que le moment serait venu où nous pourrions parler ensemble de toutes ces années écoulées, du passé de chacun, de ce que nous avions l’un et l’autre accompli dans la vie, et qu’enfin je serais délivrée d’une entrave, d’un poids trop lourd que j’avais eu à porter jusqu’ici.
Deux ans après ma naissance, ma mère se trouva un ami. Ayant décidé de ne pas vivre ensemble, pour des raisons plus ou moins pertinentes, ils se retrouvaient durant les weekends, pendant les vacances et à certaines occasions, chacun souhaitant rester indépendant. Maman était institutrice. Son travail scolaire et mon éducation, qu’elle prenait très à cœur, l’occupaient à plein temps et même au-delà, tandis que son ami Alain se rendait régulièrement à l’étranger pour l’entreprise d’appareils électroniques dont il était le directeur. Ce « beau-père », qui ne l’était qu’à moitié, m’aimait beaucoup et je l’aimais pareillement. C’était un homme calme, pondéré, qui savait écouter tout un chacun, se montrer aimable et courtois. S’il avait été pour ma mère quelqu’un de rassurant sur qui elle pouvait s’appuyer, il était pour moi un « père à distance ». En y repensant aujourd’hui, je puis affirmer que cette situation familiale me convenait. Je n’étais nullement en manque d’autorité paternelle. Mes professeurs de danse, mes maîtres d’école, les hommes que j’admirais, et surtout ce père inconnu que je ne cessais d’imaginer, comblaient largement les vides. Ce père existait, il vivait quelque part sur la planète et je voulais savoir qui il était. Ce désir s’implantait en moi de plus en plus fort. Je n’avais qu’une idée en tête : le retrouver. Pour le moment, il n’était encore qu’un père virtuel.
Ma maturité en poche, j’optai pour l’université de Genève : français, philosophie, anglais. Ainsi, je renonçai à la danse en tant que profession, ayant pris conscience depuis un certain temps déjà des sacrifices nombreux auxquels il me faudrait consentir, des années durant, sans la moindre garantie de réussir une carrière. Beaucoup d’appelés, peu d’élus. Refrain connu.
De mon père, je savais peu de choses, le peu que ma mère a pu m’en dire. Trois fois rien ! Ils ont été amants deux mois à peine. et encore, ils n’étaient pas toujours ensemble.
Mikhaïl Vidal avait trente ans à l’époque, maman en avait vingt. Ils s’étaient connus à Genève dans un club privé où maman avait été invitée par une amie à passer la soirée.
Mikhaïl, bel homme, le genre séducteur et beau parleur, avait étudié l’art dramatique à Paris. Assez vite, l’écriture prit le pas sur la comédie. Il vivait d’expédients ou signait çà et là des critiques de théâtre, de cinéma ou de littérature. Il avait pondu quelques scénarios qui n’avaient pas trouvé preneur, des poèmes publiés dans quelque obscure revue – nous ignorions laquelle – enfin, édité à Paris sous un pseudonyme, un roman dont on ne savait rien, ni le titre, ni le nom de l’éditeur. Mikhaïl Vidal avait été élevé par sa mère, également comédienne, russe d’origine et divorcée peu de temps après son mariage. Elle vivait à Prague depuis quelques années à l’époque où maman et Mikhaïl se sont rencontrés.
À la mi-novembre 1979 ils vont passer une quinzaine de jours en Valais, à Montana. Je savais encore qu’il parlait le russe, qu’il avait de la tendresse et de l’admiration pour sa mère. Mikhaïl venait d’arriver à Genève où il ne connaissait personne. Descendu dans un petit hôtel, il s’était fait enregistrer sous son patronyme – les archives de l’établissement en question me l’ont confirmé. Voilà à peu près tous les renseignements que je détenais.
Vouloir retrouver cet homme, vingt ans après son départ soudain, tenait de la gageure, de l’aventure absolue. Il vivait quelque part en Europe, mais où ? En France, à Paris ? Vivait-il en Crimée, ou ailleurs ?
J’allais avoir bientôt vingt ans, j’avais tout le temps de m’inscrire à l’Université. Je décidai alors d’entreprendre des recherches. J’y mettrais le temps qu’il faudrait, même si je devais y passer quelques années. Une détermination inébranlable m’animait comme s’il s’était agi d’une question de vie ou de mort. J’avais la certitude que rien ne pourrait m’arrêter.
Un soir où Alain et maman sont à la maison, je demande à leur parler et leur fais part de mon projet un peu fou. Je déballe tout, en bloc, et leur explique également que je pourrai commencer l’Université en automne 2001, peut-être même l’année suivante. Maman paraît effrayée. L’idée que je veuille retrouver l’homme qu’elle a aimé vingt ans auparavant la déconcerte. Même si elle comprend que j’éprouve le besoin de rencontrer un jour mon père, elle a peur que j’aille au-devant de nombreuses déceptions sans jamais parvenir à mes fins, que tout ce que j’idéalise soit finalement réduit à néant par des découvertes inattendues, une réalité différente de celle que j’avais imaginée et que je revienne fragilisée, meurtrie. Alain, qui ne se départ jamais de son calme, voit la situation d’un tout autre œil. Il pense au contraire que quoi qu’il arrive je n’aurai pas cherché en vain, que la vie m’aura appris beaucoup même si je dois être déçue. Me connaissant, il est sûr que j’en sortirai grandie et que l’expérience vaut la peine d’être tentée. Alain est très pragmatique, aussi la réalité matérielle d’un tel projet s’impose-t-elle à lui immédiatement : je devrai voyager, sillonner l’Europe. Il est prêt à m’aider. Il me propose de travailler quelques mois dans son entreprise contre un salaire convenable. Si cet apport ne devait pas suffire, il m’avancerait le reste. Maman ne dit plus rien, elle semble abasourdie, tandis qu’Alain cherche à la rassurer. « Ta fille a la tête sur les épaules, elle se débrouillera parfaitement. »
J’ai parlé de mon projet à mes grands-parents, ils m’ont également offert leur aide.
J’ai donc passé quatre mois devant un écran d’ordinateur dans les bureaux de mon beau-père à rédiger du courrier, taper des offres ou des factures. Pendant ce temps, j’ai commencé mes premières investigations. J’ai pris contact avec l’ambassade de la république tchèque. Est-ce que madame Maïka Vidal, française par son mariage, russe d’origine, dont j’ignore le nom de jeune fille, habitait à Prague ? La réponse, négative, mit du temps à venir, mais elle m’apprit qu’aucune personne de ce nom ne résidait dans la capitale tchèque, ni même ailleurs dans le pays. Je supposai que Maïka Vidal, si elle vivait réellement à Prague depuis quelque vingt-cinq années, devait avoir repris son nom russe. Ayant divorcé peu de temps après son mariage à Paris, il est probable qu’elle ait renoncé assez vite à son patronyme français, du moins avant de quitter Paris pour retourner dans un pays de l’est. L’ambassade d’Ukraine n’a pu me fournir aucune information à ce sujet. Tout s’était passé sous le régime communiste de l’époque. Les chamboulements survenus dans le monde diplomatique et consulaire d’alors ne permettaient pas de remonter si loin. Il était également probable que madame Vidal soit venue en France sous un faux nom en quittant l’URSS illégalement. Elle était donc inconnue au bataillon, selon l’expression chère à mon grand-père. De l’ambassade de France à Berne, je n’obtins guère plus d’informations concernant le fils. Il y avait de nombreux Vidal à Paris et de par la France, mais aucun ne se prénommait Mikhaïl et aucun n’était né de mère russe. Ce Mikhaïl Vidal devait pourtant exister quelque part. Parfois, je me demandais si c’était là son vrai nom. en 1979, serait-il venu ici sous une fausse identité, l’attribuant du même coup à sa mère ? Le cas échéant, pourquoi ? Mes recherches se révélèrent plus difficiles que prévu. Maman m’incitait à renoncer, mais je n’en fis rien.




